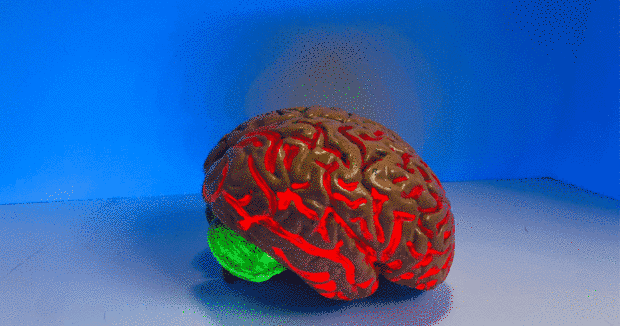Huit millions de personnes dans le monde, deux cent mille en France. C’est le nombre de personnes touchées par la maladie de Parkinson. Responsable d’une carence en dopamine dans le cerveau du patient, cette maladie se traduit par des troubles moteurs, des douleurs et de nombreux autres symptômes. Côté traitement, le constat n’est pas franchement satisfaisant. La prise orale et répétée du médicament L-Dopa a non seulement une efficacité limitée dans le temps, mais peut provoquer des complications motrices invalidantes au bout de plusieurs années – chez 50% des patients après 5 ans et 80% après 10 ans. Les personnes atteintes fluctuent alors sans cesse entre des périodes de surdosage caractérisées notamment par des mouvements incontrôlés, des périodes de contrôle et des périodes de sous dosages avec la résurgence des signes de la maladie : lenteur, raideur, tremblement, douleur, mal-être, anxiété etc. Pour trouver une alternative le CHU de Lille a donc effectué un partenariat avec la start-up InBrain Pharma.
Voilà pour le contexte de mise en route de DIVE, nouvel essai clinique qui, là où le médicament L-Dopa se transforme en dopamine dans un second temps, a pour objectif d’apporter directement cette molécule biochimique au cerveau. Le Professeur David Devos, co-fondateur d’InBrain Pharma, résume le procédé en une « plongée dans le cerveau (…) sur le modèle de l’administration d’insuline chez les patients diabétiques. »
Une injection via un cathéter depuis la zone abdominale
Mais comment cela se traduit-il concrètement ? Le procédé est le suivant : une solution de dopamine est d’abord stockée à l’intérieur d’une pompe implantée sous la peau du patient, au niveau de la région abdominale ; et c’est un fin cathéter qui va naviguer de manière contrôlée la dopamine jusqu’au cerveau (on parle d’administration cérébrale). Précisons que si l’injection se fait en « condition anaérobie », c’est-à-dire à l’intérieur du corps, c’est bien pour éviter l’oxydation (et donc la dégradation) de la dopamine, molécule précieuse mais fragile, au contact de l’air. Aussi, le fait que le patient ait une pompe au niveau du ventre lui évite d’être piqué tous les jours avec des dispositifs externes qui demandent des remplissages quotidiens. Avec DIVE, l’alimentation de la pompe à dopamine s’effectue toutes les une à deux semaines, ce qui, il faut bien l’avouer, reste moins contraignant.
Quant à la solution de dopamine, pas de risque de rencontrer des problèmes d’approvisionnement puisqu’elle est produite par la pharmacie centrale du CHU de Lille, sous la responsabilité du Pr Pascal Odou, selon un processus de fabrication originale.


Un concept ergonomique et sécurisé selon les résultats actuels
Dans le cadre de l’essai clinique, le CHU de Lille a voulu comparer le traitement conventionnel et DIVE. Durant plusieurs semaines, les patients sous traitement DIVE ont noté dans un agenda les résultats qu’ils observent à leur domicile et dans leur vie quotidienne. Il a été établi qu’avec une dose modérée (environ 100 mg par jour), on observe une forte réduction des effets de surdosage à plus de 50%, ainsi qu’une période doublée du contrôle idéal. Quand le patient reçoit une administration de doses plus fortes (presque 200 mg par jour), il a été constaté qu’un contrôle encore plus important des fluctuations motrices s’opère, avec 80% de période de contrôle idéal.

Autre avantage, DIVE, dont l’essai clinique est toujours en cours de phase I/IIB, paraît être une solution moins invasive pour le patient, plus simple et également moins risquée. C’est en tout cas ce que tient à confirmer le CEO d’InBrain Pharma, le Dr Matthieu Fisichella : “La sécurité et l’effet clinique de notre traitement semblent exceptionnels. Notre approche symptomatique avec un rationnel scientifique très fort nous sécurise sur la réussite de notre futur essai clinique de phase III”. Une phase III qui permettra aux équipes d’obtenir une autorisation de mise sur le marché pour, à terme, commercialiser ce traitement porteur d’un certain espoir pour les patients.
Pauline Villesuzanne avec le CHU de Lille